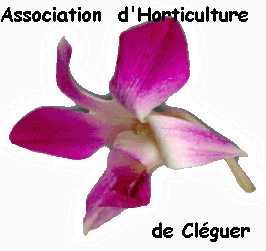| Le verger
LE VERGER EN NOVEMBRE : Planter un arbre et attendre de cueillir les fruits sans rien faire relève d'un espoir chimérique. L'arbre fruitier, comme tout être vivant, doit faire face à de multiples agressions.
Agressions par d'autres êtres vivants : bactéries, champignons, insectes, acariens, etc… Or tout ce qui porte à l'intégrité de l'arbre fruitier se répercute sur la production qui baisse en quantité et en qualité. Pour atténuer les conséquences néfastes des maladies et des ravageurs animaux, l'amateur pense en premier lieu à traiter ses arbres avec les produits chimiques du commerce.
Il est souhaitable que les traitements chimiques doivent venir qu'en dernier recours .
Avant d'en arriver là, l'amateur devra épuiser toute la panoplie des mesures préventives.
Un arbre qui ne trouve pas les conditions favorables à sa croissance devient plus sensible aux maladies et aux insectes.
L'arbre fruitier entretient d'étroites relations avec le milieu dans lequel il vit : le sol et le climat. Tous les sols ne conviennent pas à toutes les espèces fruitières. Le prunier et le poirier se plaisent dans les terres argileuses et limoneuses, le pêcher et le cerisier dans les sols légers, sablo-limoneux. Quant au pommier, il s'accommode de tous les sols, encore qu'il existe des différences entre les variétés.
L'excès d'humidité du sol provoque l'asphyxie radiculaire. L'eau en excès envahit les pores du sol en chassant les gaz, y compris l'oxygène, ce qui entraîne le dépérissement et la mort de des racines.
Cet accident se manifeste par un mauvais débourrement des bourgeons au printemps et des flétrissures de pousses.
Vis à vis du climat, nous sommes impuissants. Dans le choix des variétés, on privilégiera des espèces locales plus résistantes aux maladies, on adoptera une large distance de plantation, on formera une charpente aérée évitant tout fouillis de la végétation.
A l'inverse, dans les zones sèches et chaudes, on échappe aux maladies mais on devra craindre le pullulement des insectes. On prêtera une attention plus particulière aux insectes auxiliaires et à leur protection. On ne peut pas planter n'importe quoi n'importe où, il existe des zone privilégiées pour chaque espèce fruitière.
Aux niveaux des maladies fréquentes : cloque du pêcher, moniliose, chancre, tavelure, oïdium, il existe des résistances naturelles chez certaines variétés.
- Chez le pêcher : Grosse mignonne hâtive; Madame Girerd; Fertile de septembre; Amsten, sont peu sensibles à la cloque. Fertile de septembre et Carman sont peu sensibles à la moniliose.
- Chez le pommier : Akane et Idarerd sont résistantes à la tavelure.
- Chez le poirier : Conférence est résistante à la tavelure.
La rugosité des pommes n'est pas une maladie; c'est la conséquence d'un phénomène anatomique qui intéresse les couches protectrices du fruit. Ce phénomène peut être normal et explique l'aspect naturellement gris de certaines variétés, comme la pomme Canada gris. Des causes diverses, auxquelles les fruits sont habituellement sensibles pendant environ deux mois après leur formation, peuvent perturber le développement de leur épiderme. Un liège cicatriciel apparaît. Exemple : la Golden délicious. Cette rugosité est alors qualifié d'accidentelle.
Quant aux ravageurs animaux, la nature vient à notre aide par le truchement de la faune auxiliaire. Que sont-ils ? Les oiseaux d'abord. De plus, des insectes, des acariens, des bactéries ou des champignons microscopiques jouent également un rôle non négligeable. Parmi les plus fréquemment rencontrés, il faut citer les coccinelles, les syrphes, les chrysopes, les punaises prédatrices et les acariens prédateurs.
Quelques chiffres :
Les Coccinelles s'attaquent aux proies les plus diverses : pucerons; cochenilles; acariens; jeunes chenilles.
Elles sont prédatrices à l'état adulte comme à l'état larvaire. (Une grosse coccinelles est capable d'ingurgiter 60 pucerons par jour).
Les syrphes : ce sont des mouches, qui ressemblent à des guêpes qui font du surplace, puis brusquement se déplacent sur le côté.
Chez les Syrphes, les larves sont seules prédatrices et s'attaquent aux pucerons. Elles consomment, au cours de leur vie, entre 400 et 700 pucerons.
Les Crysopes s'alimentent pricipalement aux dépens des pucerons mais ne dédaignent pas les acariens, les cochenilles, les psylles et les jeunes chenilles.
Une larve de crysope consomme entre 200 et 500 pucerons.
Les Punaises prédatrices sont peu visibles, car minuscules (de 2 à 4 mm) et de couleur sombre. Malgré leur petite taille, elles font un travail de nettoyage remarquable. En effet,les punaises (anthocoris, orius, mirides) aussi bien à l'état adulte qu'à l'état larvaire se nourrissent de tout. Une seule larve peut consommer durant son développement entre 300 et 600 acariens ou entre 100 et 200 pucerons. Un adulte dévore 100 acariens par jour.
LE VERGER EN DECEMBRE : Comment et où les ennemis des arbres fruitiers passent-ils l'hiver ?
Où sont les insectes ?
1° Les cochenilles ou " poux collants " comme la cochenille rouge du poirier, le lécanium du pêcher, le pou de San José,...passent toute la mauvaise saison fixés sur les parties ligneuses des arbres. Elles forment des encroûtements jaunâtres ou grisâtres sur les écorces. Ces insectes piqueurs se nourrissent de sève et les rameaux attaqués dépérissent.
2° Les pucerons hivernent principalement sous forme d'oeufs disposés en divers endroits de l'arbre : extrémités des rameaux, crevasses des vieilles écorces, voisinages des racines. Les dégats visibles sont des feuilles recroquevillées ou cloquées, des pousses tordues et des fruits petits et déformés. Ils peuvent transmettre des maladies à virus.
3° Les psylles : parmi les différents psylles, le psylle du pommier passe l'hiver à l'état d'oeuf; Les autres psylles hivernent à l'état adulte, cachés dans des endroits les plus divers.
4° Les chenilles défoliatrices sont des hyponomeutes qui s'attaquent aux feuillages des pommiers et pruniers. Les chenilles issues de la ponte déposée au mois d'août ne se nourrissent pas et passent toute la mauvaise saison cachées et rassemblées sous la carapace formée par les oeufs vides accolés entre eux. Il existe aussi des cheimatobies et es hibernies qui appartiennent toutes deux à la famille des géométrides. Les papillons font leur apparition à l'automne, juste avant les premiers froids. Les femelles disposent leur oeufs en paquet à l'extrémité des rameaux. Quant aux bombix, ils hivernent selon les espèces, tantôt sous forme d'oeufs déposés en bagues autour des rameaux(bombyx neustrien), ou en amas, protégés par les poils qui étaient à la partie postérieure du corps de la femelle (bombyx chrysorée ou cul brun), tantôt sous forme de jeunes chenilles cachées à l'intérieur du nid soyeux très épais.
5° Les autres passent en général la mauvaise saison dans des conditions telles qu'il est bien difficile de les atteindre par les traitements d'hiver. C'est, par exemple, le cas de l'anthonome du pommier qui est bien caché dans les lichens, les mousses et sous les feuilles. Il faut aussi parler ici du carpocapse qui est dissimulé dans un cocon, enfoui dans les anfractuosités des troncs, ainsi que des hoplocampes et des cécidomies des poirettes qui passent la mauvaise saison dans le sol, sans oublier les charançons phyllophages qui hivernent dans le sol,les fentes des murs et les buissons.
Où sont les acariens ?
Les "araignées rouges" hivernent soit sous la forme de femelles bien cachées sous les écorces (trétanycus urticae et vienensis), soit sous forme de minuscules oeufs rouges déposés sur les branches charpentières (panonychus ulmi, Bryobia rubrioculus). Les dégats sont importants : feuilles bronzées tombant prématurément et affaiblissement des arbres. Les traitements, juste avant le débourrement, sont les plus efficaces.
Où sont les champignons ?
Les maladies sont dues à des champignons dont les organes de conservation hivernale se forment bien souvent sur les tissus morts. Cependant, quelques parasites ont des formes hivernales qui restent sur l'arbre.
- La tavelure du poirier provoque sur les jeunes rameaux de certaines variétés des chancres qu'il faut éliminer.
- L'oïdium du pommier se trouve dans les bourgeons, rarement sous forme de périthèces mais le plus souvent sous forme de mycélium. Les bourgeons infectés sont responsables des attaques virulentes du printemps suivant.
- le gnomonia du cerisier persiste pendant l'hiver dans le tissus des feuilles qui ne tombent pas.
- Le monilia passe l'hiver dans les fruits momifiés.
- Le coryneum, ou maladie criblée, provoque sur les rameaux des chancres qu'il y a intérêt à supprimer à la taille et qui provoque un écoulement de gomme.
Les maladies chancreuses :
Le chancre commun, qui s'installe sur les pommiers et les poiriers à la faveur d'une plaie, provoque le dépérissement des rameaux. En hiver les chancres abritent des périthèces ou organes de fructification qui libèrent à la belle saison des semences (spores), lesquelles infectent les jeunes pousses.
Le chancre des maladies de conservation se rencontre sur les onglets de taille et les rameaux.
Le chancre du pêcher, dû à un champignon (fusicoccum amygdali) se manifeste par le flétrissement des jeunes rameaux et des lésions chancreuses apparaissent à la base de la portion desséchée.
Le chancre bactérien du cerisier provoque l'annulation des yeux au printemps, le flétrissement des bouquets de mai et des lésions chancreuses sur les charpentières.
Les traitements :
Sur arbres fruitiers à pépins : un traitement après la cueillette ou au début de la chute des feuilles.
Produit : de la bouillie bordelaise à 125 gr pour 10 litres d'eau.
Sur arbres à noyau : à la fin de la chute des feuilles, il faut mettre del'oxychlorure de cuivre à 150 gr pour 10 l d'eau.
LE VERGER EN JANVIER : Du bourgeon à bois au bourgeon à fleurs :
Chez les arbres fruitiers, les bourgeons floraux se forment l'année qui précède la floraison. Sur un rameau d'arbre fruitier, exemple le poirier, on rencontre trois bourgeons : l'oeil à bois, le dard et le bourgeon à fleurs.
- L'oeil à bois est inséré à l'aisselle d'une feuille. Il est le point de départ de toute végétation, et suivant la quantité de sève qu'il recevra, il évoluera en rameau brindille ou dard, surtout sur le pommier.
- Le dard est pointu avec des écailles serrées. S'il reçoit trop de sève, il donnera un rameau à bois l'année suivante. Correctement alimenté, il se transforme en bouton à fleurs. S'il ne reçoit pas assez de sève, sa base s'allonge, mais il reste latent(dard ridé). Il peut demeurer plusieurs années sans évoluer. Sa collerette doit porter de 5 à 8 feuilles durant la végétation.
- Le bourgeon à fleurs, appelé aussi lambourde, est arrondi, gonflé, globuleux et légèrement pointu. Sous les écailles, il enferme les ébauches d'une inflorescence. Il assure donc la fructification. Les bourgeons floraux contiennent uniquement des ébauches de fleurs : c'est le cas du pêcher, du prunier, de l'abricotier et du cerisier. Pour les pommiers, poiriers, cognassiers et la vigne, les bourgeons floraux sont en fait mixtes, car il produisent fleurs et feuilles.
Du bourgeon à fleurs à la pollinisation :
Au printemps, les bourgeons sur les pousses de l'année portent à leur sommet des cellules qui pourront produire, soit des pousses feuillées soit des fleurs, on dit alors qu'elles sont encore indifférenciées. Entre juin et août, certains bourgeons évoluent de façon irréversible vers la production d'ébauches florales. On appelle induction florale cette transformation des cellules végétatives en ébauche florale.
Sous qu'elle influence s'opère t 'elle?
Plusieurs facteurs dont deux sont important :le nombre de feuilles par rosette et la lumière du soleil. Une grande surface foliaire augmente l'induction florale, en particulier, les feuilles des rameaux courts, dards et lambourdes.
Les branches fruitières doivent recevoir au minimum 50% de la lumière émise sur la frondaison de l'arbre.
La présence des fruits trop importants entrave la formation des bourgeons floraux. Les pépins des fruits sécrètent de l'acide gibberellique qui inhibe l'induction florale.
Entre juillet et octobre, les cellules du bourgeon qui a évolué vers l'induction florale se différencient en éléments constitutifs de la fleur et des ébauches de sépales, pétales, étamines et carpelles vont apparaître.
Le début de la maturation des cellules sexuelles (pollens et ovules) se réalise en novembre et décembre. Puis le bourgeon rentre en dormance.
En janvier et février, le froid de l'hiver va lever la dormance des bourgeons. On appelle ça le débourrement.
Dès les premiers beaux jours de mars, les bourgeons floraux gonflent et évoluent vers la floraison en passant par des stades décrits et codifiés, selon s'il s'agit d'arbres fruitiers à pépins ou a noyaux.
Sans cette levée de dormance par le froid, les bourgeons avortent et sèchent.
Les fleurs, après pollinisation et fécondation, donneront des fruits...
Souvent la fécondation est impossible au niveau d'un arbre fruitier. Pour qu'il fructifie, associez-lui une autre variété qui fleurit en même temps et lui apporte son pollen.
La majorité des arbres fruitiers sont hermaphrodites : leurs fleurs sont constituées de gamètes mâles, (anthères) et femelles (ovaires). Certains arbres dont le pêcher et l'abricotier sont autofertiles : chez eux les grains de pollen peuvent féconder l'ovaire de la même fleur. Mais pour d'autres dits autostériles, l'arbre ne peux s'autoféconder. On a recours à la fécondation croisée. C'est indispensable chez les cerisiers et les pruniers et très fréquent pour les pommiers et poiriers.
Le Kiwi est une plante dioîque car les fleurs mâles et les fleurs femelles sont séparées et apparaissent sur des pieds différents. Toutes les fleurs possèdent un ovaire et des étamines, mais sur les pieds mâles, l'ovaire des fleurs est stérile, tandis que sur les pieds femelles c'est le pollen qui est stérile. En conséquence,il est absolument nécessaire de planter des pieds mâles à coté des pieds femelles pour assurer une bonne fécondation de ces derniers.
La lumière étant indispensable à l'induction florale, il faut favoriser sa pénétration à l'intérieur de la couronne, là ou est groupée la majorité des lambourdes. Pour celà, on prendra soin, à la taille d'hiver, de dégager le centre des arbres par la suppression des branches qui se croisent, ou trop rapprochées les unes des autres.
En été par la taille en vert (taille Lorette), on éliminera les gourmands, les rameaux longs et vigoureux au dessus de la quatrième feuille en laissant un prolongement sur chaque charpentière.
LE VERGER EN FEVRIER : Etude du sol où les plantations seront faites :
Avant d'entreprendre une plantation, il est important de connaître la composition de son terrain. Dans ce but, il y a lieu de faire quelques sondages pour vérifier la perméabilité. En profiter pour prélever des échantillons de terre afin de les faire analyser.
Composition physique :
On admet que la composition idéale d'une bonne terre fruitière doit être la suivante :
Sable 50à 60% ;
Argile 15 à 25 % ;
Calcaire 2 à 10 % ;
Humus 5 à10 %.
Si ce n'est pas le cas ,on procédera à des amendements. Dans les terrains acides, on fera des apports de calcaire. La chaux est de préférence sous forme de carbonate de chaux (chaux magnésiennes , maerl Dolomie). On étalera les apports pour éviter une remontée brutale du pH et un blocage en oligo-éléments et en manganèse.
En terrain argileux (sable), il faudra faireun amendement humifère à base de fumier de bovin (500 kg / 100m²) et de terreau de compost. La plupart des espèces fruitières croissent dans les sols à pH compris entre 6,5 et 7,5.
Composition chimique :
Les trois éléments fondamentaux de la nutrition des plantes par le sol sont : l'azote ; l'acide phosphorique et la potasse. Les teneurs souhaitables dans le sol sont : 1,5 pour mille pour l'azote, 1,5 pour mille pour l'acide phosphorique et 3 à 4 pour mille pour la potasse. L'azote favorise la croissance, et est donc importante aux arbres jeunes.
L'acide phosphorique aide à la mise à fruit, et est indiqué à l'état adulte. (Le phosphore est un correcteur de l'excès d'azote). La potasse contribue à la qualité des fruits et les rend moins sensibles aux maladies. En fumure d'entretien, on trouve dans le commerce des engrais fruitiers dits "complets" qui contiennent une proportion convenable de chacun des trois éléments.
Le rôle des porte-greffes :
Le porte-greffe permet d'adapter l'arbre fruitier à un type de sol déterminé, mais aussi de modifier sa végétation en agissant sur sa vigueur. Dans le cadre du pommier, trois porte-greffes sont principalement utilisés : le M9 pour les formes de faible vigueur (cordon), le M 106 pour vigueur moyenne (gobelet, haie fruitière, etc…) et le franc de semis pour les grandes vigueurs (plein vent). Le M 9 convient aux terre limoneuses ou argileuses et fraiches mais craint les sols secs. Le M 106 préfère les sols légers, mais redoute les sols argileux ou humides. Les francs de semis s'adaptent aux sols médiocres, peu sensibles à l'humidité.
La majorité des poiriers sont greffés sur des cognassiers d'Angers dans notre région ; Les pêchers basses formes sur Marianna, les pêchers tiges sur franc en terrain normal ; les pêchers sur pruniers St Julien en sol très humide ; les pêchers sur myrobolan en sol sec ; les cerisiers sur merisiers en sol fertile et frais ; les cerisiers sur Sainte Lucie en sol calcaire, sec ou aride. Les pruniers : même porte-greffes que les pêchers suivant les sols.
Mise en place des plants :
L'habillage des racines consiste à rafraîchir les racines et radicelles et à sectionner les parties blessées.
Le trou de plantation doit être d'un diamètre d'au moins 60 cm et de 60 cm de profondeur.
Ne pas mettre de fumier même bien décomposé au contact des racines.
Bien écarter les racines dans le trou de plantation, placer le bourrelet de greffe à environ 10 cm au dessus du sol pour éviter l'affranchissement des arbres.
Les arbres à noyaux doivent être taillés à la plantation, sinon les yeux s'annulent l'année suivante. Pour les arbres à pépins, on ne taille pas à la plantation. Si le temps est sec, arroser modérément.
Attention en distribuant l'engrais sur les jeunes plants, éviter de toucher le collet avec les granulés sinon il y a risque de brûlure de l'écorce et apparition de chancre.
Le pralinage des racines, en trempant les racines dans une boue d'argile pour 2/3, mélangée de bouse de vache pour 1/3 est intéressant car il favorise l'émission des racines. Quel que soit le temps, 10 litres par arbre à la plantation est un gage de reprise.
LE VERGER EN MARS : Pollinisation et fécondation :
La fleur est le siège de la sexualité de la plante ; outre la protection des organes sexuels qu'elle renferme, la fleur assure le fonctionnement sexuel du végétal.
La fleur n'aboutit au fruit que si elle a été fécondée. Elle comporte une partie mâle, les étamines, qui produisent le pollen porteur de gamètes mâles, et une partie femelle, les carpelles, qui contient l'ovule porteur de gamètes femelles. Le grain de pollen libéré par les étamines va se poser sur le stigmate du pistil, germe et émet un tube pollinique qui cheminant dans le pistil, atteint l'ovule. Les deux noyaux mâles du pollen fusionnent avec les deux noyaux femelles de l'ovule. C'est la double fécondation. Ce phénomène capital permet la transmission des caractères des parents aux descendants. A partir de ce moment seulement, se forme la semence (noyau ou pépin).
En l'absence de fécondation, le fruit ne se développe pas.
Quand un ovule est fécondé par le pollen des fleurs de la même variété, on dit qu'il y a autofécondation.
Lorsque l'ovule d'une fleur est fécondé par le pollen d'une fleur d'une autre variété, on dit qu'il y a fécondation croisée. Un fruit est dit parthénocarpique quand sa formation s'est réalisée sans fécondation.
Une fécondation réussie a nombre d'avantages importants. Elle améliore la qualité des fruits en augmentant leur teneur en sucres et en acides. Elle empêche la chute prématurée des fruits. Elle assure une meilleur conservation, les fruits flétrissent moins. Cette influence du nombre de pépins s'explique par le fait qu'ils fabriquent des hormones indispensables à la constitution du fruit.
Comment assurer une bonne fécondation :
Au sein d'une même espèce fruitière, une variété peut être considérée comme bonne pollinisatrice, mais elle l'est à des degrés différents ou même pas du tout selon la variété à polliniser. (Dans la majorité des catalogues des pépiniéristes, cette information est fournie).
On peut retenir les principales informations suivantes :
- Cerisiers : la plupart des bigarreaux doivent bénéficier de l'inter fécondation. Parmi les bons pollinisateurs, bigarreaux Burlat, bigarreaux Hedelfingen et bigarreaux Napoléon.
Les cerises anglaises et les guignes sont autostériles alors que les griottes sont auto fertiles.
- Pruniers : parmi les meilleurs pollinisateurs la reine Claude d'Oullins est très polyvalente. La quetsche d'Alsace, la mirabelle de Nancy et la prune Stanley sont auto fertiles.
- Poiriers : les variétés William's, conférence et Doyenné du Comice sont les meilleurs pollinisatrices. Mais il est important de respecter les inter-compatibilités.
- Pommiers : la reine des reinettes , la délicious et la Granny Smith sont en tête des pollinisatrices. Il est important de tenir compte des incompatibilités entre certaines variétés.
Causes de non fécondation :
Si la température en inférieure à 10°C, les insectes pollinisateurs ne sortent pas.
Si les pluies sont importantes pendant la floraison , le pollen gonfle et ne peut s'introduire dans le pistil.
S'il gèle à -2°C, les fleurs sont détruites.
S'il y a du vent, il y a dessèchement du stigmate.
Si ce sont des variétés incompatibles, il faut que le stigmate soit réceptif. (dichogamie, protandrie et protogynie)
Etc ...
LE VERGER EN AVRIL : Certains arbres fruitiers posent des problèmes ... (1ère partie)
Qu'ils soient jeunes ou vieux, il est possible de déterminer les causes qui sont à l'origine de la végétation languissante des arbres, de leur stérilités ou de la maturation difficile des fruits; et par conséquent, d'appliquer des remèdes appropriés. Il existe des cas particuliers, notamment lorsque les arbres présentent des signes de dépérissement.
C'est le cas, après un hiver caractérisé par de fortes gelées alternant avec de brusques remontées de la température diurne et un temps anormalement froid en avril. De telles conditions provoquent fréquemment l'avortement des fleurs ou la chute des fruits, à cause de certaines irrégularités dans la circulation de la sève montante.
L'arbre ne pousse pas normalement.
C'est souvent la conséquence d'une plantation dans une terre maigre, ou épuisée par les cultures précédentes. Les pommiers ont des besoins élevés contrairement aux cerisiers. La croissance difficile des arbres peut également s'expliquer par un ameublissement insuffisant de la terre en terrain compact après la construction de la maison par exemple. Cet accident est d'autre part habituel lorsque l'arbre a été planté en remplacement d'un autre de la même espèce, suite à la présence dans la terre de toxines abandonnées par les racines. Cela explique l'obligation de faire succéder un arbre à noyau à un autre à pépins; ou le contraire.
Le remède à apporter consiste à arroser avec une solution contenant des hormones qui stimulent l'enracinement qu'il faut dès lors verser dans des trous réalisés avec une tige de fer autour de l'arbre. Le purin de fumier de vaches contient également des hormones d'enracinement, un apport de terreau tamisé à enterrer et à l'automne, un engrais composé spécial arbres fruitiers.
L'arbre ne pousse pas mais fleurit abondamment.
Dans la majorité des cas, il s'agit d'une floraison ...(de misère ) provoquée par l'absence de fertilisation ou la sécheresse du sous-sol durant l'été précédent ou au printemps. Les feuilles ont alors une teinte anormale, jaunâtre et des nécroses peuvent apparaître entre les nervures. Cet accident se produit fréquemment lorsque le terrain est enherbé, car certains porte-greffes à enracinement superficiel ne supportent pas la concurrence radiculaire (cognassier pour le poirier type EM 9 pour le pommier). Ce qui démontre le danger des engrais verts, lorsque l'été est chaud et sec.
Le remède consiste à distribuer un engrais composé (NPK) plusieurs années de suite, et à maintenir la terre humide par des arrosages périodiques de mai à juillet. Dans le cas des poiriers et des pommiers adultes, il sera utile de pratiquer une taille hivernale assez sévère et de supprimer les boutons en surnombre.
La croissance est normale, mais la floraison est insignifiante ou nulle.
Ce défaut est inhérent à la juvénilité des arbres; elle se prolonge d'autant plus que le porte-greffe est vigoureux. Le plus souvent la mise à fruits des pommiers ne débute pas avant 3 à 4 ans pour un porte-greffe faible type (EM9), 5 à 6 ans pour (MM106) et même un peu plus. Il faut en effet que les branches se rapprochent de l'état adulte, avec suffisamment de réserves nutritives.
La taille excessive en est une cause; ce qui explique les mérites de la méthode fondée sur l'abaissement horizontal des brindilles sans les écourter. La durée de la période juvénile peut être écourtée en distribuant un engrais phosphaté à verser dans des trous réalisés avec une tige de fer. Cette fertilisation est surtout efficace dans le cas des cerisiers et pruniers.
A faire en avril.
Traiter la vigne au soufre pour limiter les risques d'oïdium, procéder entre 15° et 25°C, et quand les pousses ont deux à trois feuilles. A refaire à la floraison, puis après la formation des grains.
Surveiller les pommiers et poiriers, car avec le premier soleil, les pucerons apparaissent …
Epandre quelques poignées d'engrais (arbres fruitiers) et une demi-brouette de compost par arbre à l'aplomb de la couronne et non au pied de l'arbre.
LE VERGER EN MAI : Certains arbres posent des problèmes … (2ème partie)
La croissance est excessive.
La croissance est excessive (avec des bourgeons longs et vigoureux et un feuillage luxuriant), mais la floraison est insignifiante ou nulle. Chez les jeunes arbres, ce défaut est attribuable à la vigueur du porte greffe. Il peut être atténué en procédant à la transplantation sur place, en octobre ou novembre, afin de supprimer ou raccourcir les racines fuyantes et peu ramifiées. On devra ensuite tailler très court les brindilles qui ont tendance à prendre une direction verticale.
L'abaissement des brindilles à l'horizontale constitue ici le meilleur remède. C'est une preuve de plus que la stérilité des poiriers et pommiers adultes est généralement la conséquence d'une taille hivernale trop sévère qui supprime une partie du feuillage sans réduire en même temps les activités radiculaires. La poussée végétative est alors d'autant plus vigoureuse que la terre est nutritive, ou que la fumure est déséquilibrée par un excès d'azote (purin, fiente de poules, etc), surtout lorsque le printemps est humide. Si les causes citées n'existent pas, l'excès de vigueur peut être la conséquence d'une plantation trop profonde ayant entraîné l'émission sur la greffe pratiquée au ras du sol, de racines adventives beaucoup plus actives que celles du porte-greffe. On dit alors que l'arbre s'est affranchi du porte greffe.
On repère l'arbre affranchi à sa végétation plus vigoureuse. En dégageant le collet, on constate que les racines partent du tronc au dessus du bourrelet de greffe. L'affranchissement retarde la mise à fruits de l'arbre. Il est impératif de couper les racines partant du tronc au dessus du bourrelet. On peut distribuer des engrais phosphatés (scorie thomas :80 à 100 g/m² correcteur de l'excès d'azote et de la potasse) à verser dans des trous réalisée avec une tige de fer.
Les arbres fleurissent, mais les fruits tombent prématurément.
Lorsqu'elles se manifestent fin mai, début juin, les chutes peuvent être considérées comme normales: il s'agit des petits fruits non fécondés. Celà explique la nécessité de ne pas éclaircir manuellement les fruits avant la fin juin. Les fruits mal fécondés, qui contiennent peu de pépins, tombent également lorsque les conditions de nutrition ne sont pas favorables (sous sol anormalement sec, etc). Cet accident est imputable,dans la majorité des cas, à une carence nutritive, par rapport aux besoins des arbres.
Le remède consiste à arroser copieusement les arbres, surtout les cerisiers, les pruniers et les abricotiers, d'abord une dizaine de jours avant la floraison et ensuite lorsque les pétales commencent à tomber, cette fois en utilisant une solution nutritive activante (nitrate d'ammoniaque ou de potasse :30 gr/m²). Lorsque les chutes sont habituelles, sur les poiriers et pommiers, il est utile de supprimer durant l'hiver, les vieilles bourses et les boutons en surnombre.
Les fruits tombent prématurément alors que leur épiderme commence déjà à se colorer.
Cet accident est fréquent avec certaines variétés: Beurré Hardy, Clapp's favorite, Conférence, Comtesse de Paris pour les poires et pour les variétés James Grieve, Reinette étoilée et Cox's Orange pour les pommes.
La maturité étant régie par la quantité d'hormones produite par l'arbre, l'évolution des fruits est ralentie dès que la production des substances hormonales diminue, avec comme conséquence, la formation à l'endroit de l'insertion du pédoncule d'une zone fragile, qui facilite le détachement des fruits lorsque le temps est venteux. Cet accident est fréquent lorsque les arbres fortement chargés ne disposent pas d'une alimentation suffisante. Ce qui implique de lui attribuer un engrais composé si le temps est humide ou durant l'automne.
A faire en mai.
Supprimez les tiges faibles de framboisiers et cassissiers.
Eclaircissez les pêchers, secouez doucement les branches, conservez deux fruits par bouquet: c'est amplement suffisant.
Palissez les fruitiers en espaliers ou en cordons.
Ebourgeonnez la vigne et raccourcissez les tiges trop longues, traitez-la contre l'oîdium et le mildiou en la pulvérisant avec du soufre et de la bouillie Bordelaise.
Traitez les pommiers et poiriers contre la tavelure.
LE VERGER EN JUIN : Certains arbres posent des problèmes … (3ème partie)
L'arbre a toujours bien fructifié et, subitement, les branches ne fleurissent plus ou très peu.
Cet accident peut être la conséquence d'un éclairement insuffisant. Lorsque la fructification se produit une année sur deux (ou trois) parfois malgré une floraison annuelle, l'alternance résulte d'un déséquilibre nutritif. Etant donné que la production fruitière est alors abondante, l'entièreté des matières nutritives accumulées dans le bois est utilisée pour nourrir les fruits. Dans ces conditions,l'arbre a besoin d'une année de repos pour reconstituer des réserves destinées à assurer la formation des fleurs. Le rééquilibrage est souvent contrarié par la sécheresse de la terre durant l'été ; ce qui démontre encore une fois l'obligation d'arroser les arbres correctement même si le temps est pluvieux, car durant les mois chauds, les eaux naturelles atteignent difficilement les racines profondes.
Une précaution supplémentaire consiste à ne pas négliger de distribuer un engrais azoté (nitrate d'ammoniaque : 20 à 40 g/m² après la floraison). Les engrais " foliaires " à pulvériser sur le feuillage sont surtout avantageux lorsque l'humidification de la terre profonde est difficile à réaliser, et également par temps froid. On les utilise de fin juin à fin août . L'alternance est un phénomène fréquent chez les variétés de vigueur modérée, mais douées d'une grande fertilité.
Les fruits se colorent difficilement
Deux facteurs essentiels semblent influencer directement le développement de la couleur des fruits; en l'occurence, la composition chimique de la chair et l'exposition à la lumière. Les fruits ensachés durant l'été se colorent plus intensément que ceux laissés à l'air libre. L'humidité joue également un rôle essentiel, de même que les températures nocturnes assez basses; la production des anthiocyanes est stoppée à 25°.
L'alimentation des arbres exerce une influence certaine: l'excès d'azote donne des fruits peu colorés principalement dans les terrains carencés en potasse et en phosphore. C'est l'occasion de rappeler que les arbres peuvent fort bien souffrir d'une carence potassique, alors que cet élément existe dans la terre. Ce phénomène est la conséquence du blocage de la potasse sous une forme inassimilable par les racines, notamment dans les terrains qui ont bénéficié d'un chaulage inopportun.
A faire en juin- juillet: La taille d'été ou taille lorette
Les interventions d'été s'appliquent aux pousses de l'année qui sont à peine lignifiées.
Les avantages sont : le contrôle de la végétation, la stimulation des bourgeons à fruits et l'amélioration de la qualité des fruits. La taille d'été tend à affaiblir l'arbre, elle doit être pratiquée sur des arbres bien alimentés et de vigueur suffisante sinon elle aggrave l'état des arbres déficients.
Chaque organe en croissance (rameaux feuillés, fleurs, fruits) exerce vis-à-vis des organes voisins une double influence : compétition pour les éléments nutritifs et contrôle de développement d'origine hormonale. Les effets de la taille d'été dépendent aussi de la position du rameau qu'on supprime et de la date d'intervention. La taille d'été peut être employée pour la formation de l'arbre en taille d'entretien et comme technique de mise à fruits.
Pendant la formation de l'arbre, on favorisera la croissance des futures charpentières en supprimant, au printemps et en été, les pousses inutiles et concurrentes. Opération impérative dans la formation des arbres à noyaux (gobelet, fuseau etc ). Pour se faire, on pince à trois feuilles les pousses concurrentes.
La taille d'entretien à faire à la belle saison vise à maintenir une bonne aération de la charpente; ce qui rend possible la pénétration de la lumière à l'intérieur de la couronne. La lumière solaire joue un rôle prépondérant dans la fructification: induction florale et formation des bourgeons. La lumière est le facteur indispensable de la fonction chlorophyllienne exercée par les feuilles.
On supprimera les rameaux verticaux à trois feuilles, les gourmands, les brindilles faibles, les rameaux qui poussent à l'ombre et on conservera un prolongement par branche charpentière.
LE VERGER EN AOUT : Le Figuier (ficus acaria)
Les fleurs du figuier sont très particulières puisqu'elles sont placées dans une inflorescence qui se transforme, après fécondation, en une infructescence. Les véritables fruits sont les grains contenus dans la figue, et le fruit si apprécié pour sa chair est constitué du réceptacle floral et des fleurs gonflées de nectar sucré appelé "sycone".
Si les fleurs du figuier sont particulières, son mode de fructification l'est tout autant. On peut distinguer sur un rameau de l'année, deux types de figues :
- Les figues d'automne, encore appelées les secondes, qui naissent et mûrissent la même année (à condition que le figuier bénéficie d'une situation thermique privilégiée) ;
- Les figues -fleurs, encore appelées les premières, ou figues de l'été, qui éclosent à l'automne à l'aisselle des feuilles dans la partie supérieure du rameau, qui y passent l'hiver et qui poursuivent leur développement l'année suivante pour mûrir dans le courant de l'été.
Les variétés ne produisant que des figues d'automne sont dites "unifères" et celles produisant des figues d'automne et des figues fleurs sont dites "bifères".
Les figuiers sauvages, ou caprifiguiers, encore baptisés figuiers mâles portent des fruits non comestibles, mais d'une importance capitale, car ils renferment les blastophages, petits hyménoptères chargés de la pollinisation.
Les variétés unifères donnent une seule récolte de figues à l'automne, (certaines dès le mois d'août), sexuées ou parthénocarpiques selon les variétés.
Les figuiers bifères offrent une première production de figues-fleurs qui se développent sur le bois de l'année précédente à partir de juillet. Ces fruits sont parthénocarpiques.
La limite à la culture du figuier est imposée par le froid. De - 10 à - 12°C.
Sans exigence particulière pour le sol , il doit quand même être planté dans l'endroit le plus chaud du jardin et à l'abri du vent.
les variétés sont à la disposition des adhérents.
La Framboise (Rubus idaeus) (une plante de sous-bois)
Le framboisier croît à l'état spontané dans les sous-bois montagneux. C'est une plante de clairière fréquentant les lieux frais et mi-ombragés. Il aime les terres légères, plutôt acides et riches en humus.
On distingue deux types : le framboisier non remontant et le framboisier remontant ou bifère.
Le framboisier non remontant fructifie sur le pousses de l'année précédente. La première année, la souche produit des drageons qui , en hiver, entrent en repos. Au printemps suivant, les bourgeons de ces tiges d'un an donnent naissance à de petits rameaux latéraux qui porteront fleurs et fruits. Après la récolte, les cannes se dessèchent et meurent.
Le framboisier remontant fructifie deux fois par an, la première fois sur la pousse de l'année, en septembre-octobre, la deuxième fructification se faisant sur la même tige mais l'année suivante en juin-juillet. Les cannes ayant fructifié les deux fois meurent et font place à une nouvelle génération.
Les racines du framboisier sont sensibles et fragiles. Evitez de planter dans les sols asphyxiants et dans les terres séchantes.
La maturité s'échelonne de la mi-juin à la fin juillet pour les variétés non remontantes et de la mi-août à la fin octobre chez les variétés remontantes.
La mûre et la ronce
On réunit sous le nom de mûres, de nombreuses espèces du genre rubus, ou ronces, dont les fruits ne se détachent pas du réceptacle à maturité. Les Anglo-Saxons les appellent " berry ".
La ronce comme le framboisier est un semi arbuste. Le système radiculaire émet chaque année des pousses vigoureuses pouvant dépasser 5m. La fructification se réalise sur le bois de l'année précédente qui portent des rameaux latéraux fructifères.
En fin de saison, les tiges ayant fructifié se dessèchent, meurent et sont remplacées par de nouvelles pousses.
Contrairement aux framboisiers, les ronces demandent un climat tempéré chaud. Elles craignent les grands froids qui occasionnent le gel des tiges. Les gelées printanières peuvent causer des dégâts aux boutons.
Attention au vent qui casse les tiges. En hiver, on aura soin de protéger les souches contre le froid en les recouvrant de paille, ou litière de feuilles.
les variétés sont à la disposition des adhérents.
LE VERGER EN SEPTEMBRE : La récolte.
En Septembre on récolte beaucoup de fruits, prunes; pêches; framboises; raisins; poires; pommes; etc… Les fruits d'été se consomment dans les quinze jours, exemple: prunes pêches et framboises. Par contre la plupart des pommes et poires doivent séjourner au fruitier de quelques semaines à plusieurs mois selon les variétés. Tout d'abord, il faut veiller à cueillir les fruits à bonne maturité. Un fruit cueilli trop tôt a un goût acide, et cueilli trop tard, se conserve mal et devient vite farineux ou blet. Ne pas cueillir des fruits par temps de pluie et éviter de les entasser en plusieurs couches. Chez la pomme les pépins brunissent et le fruit se détache facilement. La présence de nombreux pépins est un gage de bonne conservation. Enfin, il ne faut rentrer au fruitier que des fruits sains, sans blessure, indemnes de maladies ou piqûres d'insectes. La moindre plaie ou meurtrissure, la plus petite éraflure, le plus petit choc font pourrir les fruits, parfois en quelques jours. Ce sont les différentes variétés de poires ou de pommes qui font varier le moment le plus favorable à la récolte et où les fruits ont atteint leur maturité physiologique. Alors, ils n'ont plus rien à attendre des arbres. Ce n'est que lorsqu'ils ont fini de mûrir, quand ils sont les meilleurs à consommer, qu'ils ont atteint leur maturité gustative. Ces deux maturités sont parfois assez éloignées l'une de l'autre.
Le calcium joue un rôle primordial dans la tenue des fruits en conservation. Il augmente la fermeté du fruit, favorise la synthèse des protéines. Le calcium ralentit la respiration des fruits. L'insuffisance de calcium dans les fruits se traduit par une tendance au brunissement et au ramollissement de la chair et une plus grande sensibilité aux pourritures. Le manque de calcium provoque chez la pomme la maladie des taches amères. A l'approche de la maturité, la pomme présente des taches rondes, déprimées. Sous ces taches, la chair est liégeuse et amère.
Une fois détaché de l'arbre, le fruit cueilli arrête sa croissance mais n'arrête pas son évolution. La maturation est caractérisée par de nombreuses synthèses qui vont modifier les caractères du fruit. Par exemple une poire qui mûrit devient colorée, sucrée, fondante. Plusieurs origines contribuent à ces transformations.
La transpiration: Après la cueillette, le fruit n'est plus alimenté en eau, donc il va perdre son eau et en conséquence, il va perdre du poids.
La respiration: En respirant, le fruit absorbe de l'oxygène et rejette du gaz carbonique. La respiration provoque la transformation de l'amidon en sucres solubles, des glucides en acide s organiques et en protéines. La respiration dégage de la chaleur. Pour maintenir les fruits à basse température, il faut aérer le fruitier.
L'évolution de l'amidon, des sucres et de l'acidité: Au cours de la croissance sur l'arbre, le fruit accumule de l'amidon. A l'approche de la récolte, la teneur baisse pour disparaître au début de la maturité. L'acidité décroit ainsi que les tanins.
L'évolution des pigments: L'origine du changement de couleur des fruits. Les parties vertes contiennent encore un peu de chlorophylle. Quand la maturité avance, la chlorophylle disparaît et est remplacée par des pigments caroténoïdes jaunes ou orangés qui donnent la couleur aux fruits mûrs.
L'émission d'éthylène: les pommes et les poires émettent de l'éthylène pendant leur maturation. Cette substance accélère le processus de maturation et de vieillissement des fruits. Sa présence se révèle néfaste à la bonne conservation.
Chez les fruits qui murissent, on observe un dégagement de chaleur, une augmentation des sucres et de l'éthylène. A l'inverse, il y a réduction de poids, de l'amidon, de l'acidité et de la chlorophylle.
Le Fruitier.
Le principe du fruitier ventilé est simple: les fruits sont stockés dans un local fermé sans refroidissement artificiel, et seules les températures basses retardent la maturation. La pièce doit avoir une bonne isolation thermique. L'exposition la plus favorable est nord ou est. Un sol en terre battue constitue un excellent isolant. L'installation de bouches d'aération en partie haute est indispensable pour l'évacuation du gaz carbonique et de l'éthylène.
La température doit être la plus basse possible, mais pas gélive. 4 à 8°C est une bonne moyenne. L'introduction de l'air froid extérieur peut se faire à partir d'un petit ventilateur.
L'humidification du local (85 à 90% d'humidité) a pour objectif d'empêcher ou d'atténuer le flétrissement des fruits consécutif à la transpiration.
Les étagères doivent avoir des rayonnages fixes superposés de 30cm en 30 cm, ou tout simplement des clayettes à claire-voie posées sur des caillebotis et les unes sur les autres.
Quel que soit le procédé employé, il est impératif de respecter les trois conditions : refroidissement, ventilation et humidification.
A SUIVRE ...
___________________

| |